Un enseignement tenant compte des traumatismes : introduire l’Holocauste en classe
Les élèves canadiens viennent de tous les horizons et arrivent dans nos salles de classe avec un large éventail d’expériences. Lorsque nous enseignons des sujets aussi complexes que l’Holocauste, il importe d’adopter une approche tenant compte des traumatismes afin de soutenir au mieux nos élèves.
Prenez quelques instants pour vous remémorer la première fois que vous avez appris l’existence de l’Holocauste. Où étiez-vous ? Quel âge aviez-vous ? Qu’avez-vous ressenti ? Quelles ressources ont été utilisées pour introduire le sujet ? À l’école, vous avez peut-être assisté à la présentation d’un survivant ou d’une survivante, ou encore été marqué par un livre ou un film portant sur l’Holocauste. Gardez à l’esprit que vous serez possiblement à l’origine du premier souvenir sur l’Holocauste de quelqu’un. Cette responsabilité considérable pose un défi certain au personnel enseignant. Pour vous aider à le relever, nous vous proposons des stratégies et des ressources qui vous permettront d’adopter une attitude proactive dans la planification de vos cours sur l’Holocauste et d’accompagner adéquatement chaque élève de votre classe dans son apprentissage.
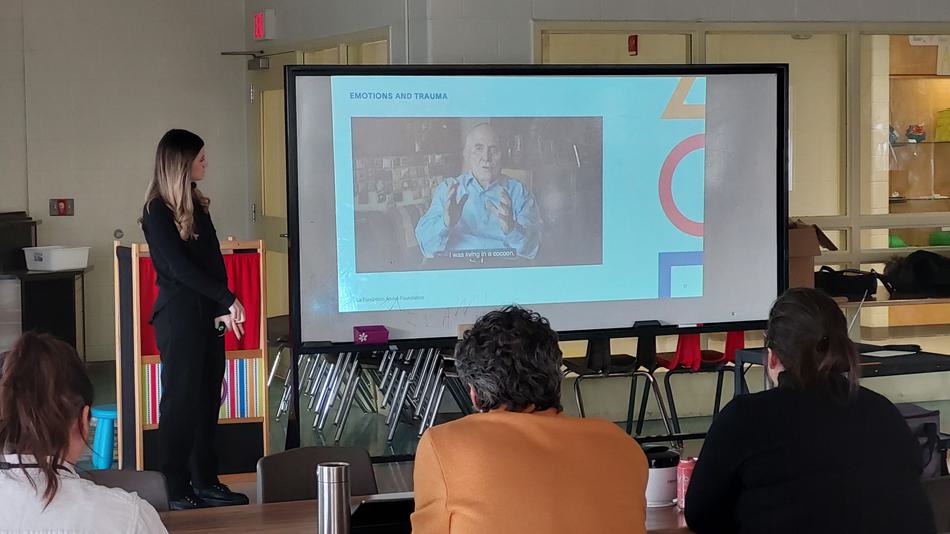
Qu’est-ce qu’un traumatisme ?
Puisque nous sommes des enseignants et des enseignantes et non des thérapeutes, définissons d’abord ce qu’est un traumatisme : on entend par traumatisme1 tout événement ou toute situation qui dépasse la capacité d’une personne de s’y adapter.
Un traumatisme peut affecter les élèves sur les plans physiologique, cognitif, émotionnel et comportemental.
En classe, les vécus traumatiques ont une incidence sur l’épanouissement et la réussite de chacun et de chacune : lorsqu’un ou une élève vit un traumatisme, ses processus d’apprentissage sont perturbés.
En quoi consiste une approche tenant compte des traumatismes ?
Les enseignants et les enseignantes qui empruntent une approche tenant compte des traumatismes s’entendent sur le vocabulaire et les pratiques à adopter pour créer un milieu d’apprentissage sûr, inclusif, bienveillant et empreint de respect. Bien comprendre les diverses manifestations d’un traumatisme vous permettra de reconnaître les situations dans lesquelles un élève pourrait ressentir de la détresse. En outre, l’intégration de ces stratégies dans votre enseignement et la mise en place d’un cadre rassurant aideront les élèves à réguler leurs émotions et à faire preuve d’empathie à leur tour.
Pourquoi l’enseignement tenant compte des traumatismes est-il pertinent dans le contexte de l’éducation sur l’Holocauste ?
Présenter l’histoire de l’Holocauste est complexe et exige d’explorer de nombreux sujets difficiles. Lors de votre enseignement, vous serez indubitablement amené à aborder une partie ou l’ensemble de ces thèmes :
- les mauvaises conditions de logement
- les disparités dans l’alimentation
- les restrictions en matière d’éducation
- la maladie
- le racisme et la discrimination
- la cruauté
- la violence et la maltraitance (physiques et émotionnelles)
- la mort et les assassinats
- la fuite face à des situations dangereuses
- la perte d’un être cher
- la guerre
- tout autre traumatisme personnel ou événement marquant
En parcourant cette liste, vous avez peut-être constaté que plusieurs de ces éléments constituent des enjeux actuels dans la vie des familles canadiennes. Dans la planification des unités d’apprentissage sur l’Holocauste, il importe de tenir compte du vécu individuel des élèves, des expériences de leur famille et des événements dont ils pourraient avoir été ou être témoins au sein de leur communauté.
Comment intégrer une approche tenant compte des traumatismes dans l’enseignement de l’Holocauste ?
Vous profiterez de l’adoption des pratiques décrites ci-dessous, peu importe la matière enseignée, et il est probable que vous ayez déjà recours à certaines d’entre elles dans votre classe. La mise en œuvre de ces stratégies ne nécessite que quelques ajustements mineurs à votre programme existant. Pour plus d’information, veuillez consulter ces ressources supplémentaires.
Apprenez à connaître vos élèves
Dans la mesure du possible, essayez de connaître vos élèves sur le plan personnel. Nous ne recommandons pas d’enseigner une activité d’apprentissage sur l’Holocauste dès le mois de septembre, car il est peu probable que vous les connaissiez suffisamment bien à ce stade de l’année scolaire. Maintenez une communication ouverte avec vos élèves et leurs familles, et avec les ressources de soutien dont ils bénéficient. Lorsque vous aurez une meilleure idée du comportement habituel de l’élève, vous serez en mesure de discerner les changements qui surviennent chez lui. Ainsi, vous identifierez plus aisément les élèves qui pourraient avoir besoin d’un soutien supplémentaire ou d’un suivi dans le cadre de l’activité.
Faites de votre classe un espace sûr
Créez un espace où les élèves peuvent poser des questions et exprimer leurs opinions et leurs sentiments sans contraintes. Au début de votre unité d’apprentissage sur l’Holocauste, définissez clairement vos attentes quant à l’utilisation d’un langage respectueux et d’une écoute active, et insistez sur l’importance de la tolérance et du soutien mutuel au sein de la classe. La méthode consistant à créer un contrat de classe, expliquée sur le site Facing History & Ourselves, constitue un excellent outil à cet égard. La leçon intitulée Untitled Poem by Beth Strano2, proposée par cette ressource, peut être utilisée pour entamer des conversations ouvertes sur des sujets difficiles.
Réfléchissez bien au contenu et à la méthodologie choisis
Assurez-vous que les sujets et les thématiques abordés conviennent à l’âge des élèves et que les méthodes d’enseignement correspondent aux meilleures approches en matière d’éducation sur l’Holocauste. Évitez d’avoir recours à des supports visuels ou à des récits trop explicites ou choquants. L’engagement des élèves à l’égard du contenu présenté sera facilité s’il est adapté à leur stade de développement.
Soyez présent et disponible pendant et après l’unité d’apprentissage
Observez le comportement de vos élèves pour repérer tout changement qui pourrait être un signe de détresse. Tout au long de l’activité, invitez vos élèves à interroger leur ressenti, que ce soit à l’aide d’un carnet de bord, d’entretiens individuels ou de brèves discussions en petits groupes. Écoutez activement les conversations entre vos élèves et soyez à leur disposition pour tout suivi. Évitez de confier ce genre d’activité d’apprentissage à un enseignant suppléant.
Offrez à vos élèves la possibilité d’explorer et de choisir
Donnez aux élèves la possibilité de faire des choix autonomes quant à leur apprentissage. Si vous ne souhaitez pas qu’ils se servent librement de moteurs de recherche comme Google, vous pouvez néanmoins leur accorder une certaine autonomie en leur proposant un cadre bien défini dans lequel ils pourront explorer certains sujets. Par exemple, si les élèves consultent notre ressource numérique Re:Collection, suggérez-leur quatre ou cinq thèmes parmi lesquels ils pourront choisir ceux qu’ils souhaitent explorer. Une recherche ainsi circonscrite outillera vos élèves à aborder progressivement le sujet délicat de l’Holocauste, en priorisant eux-mêmes les thèmes qu’ils souhaitent découvrir et en reportant l’exploration de ceux qu’ils considèrent comme trop bouleversants.
Soyez bien préparé en disposant des ressources nécessaires
Avisez les familles des élèves, vos collègues enseignants, l’équipe administrative ainsi que le personnel de soutien psychosocial de votre établissement de votre intention d’enseigner une unité d’apprentissage sur l’Holocauste. Prévoyez des ressources pour les élèves qui nécessiteraient du soutien additionnel. Pensez aussi à vous tourner vers vos collègues afin qu’ils et elles puissent être là pour vous épauler au besoin.
Évitez de faire des suppositions
Ne faites pas de conjectures au sujet du vécu de vos élèves et de leur historique familial. Même si vous ne pensez pas avoir d’élèves dans votre classe qui sont personnellement affectés par l’Holocauste, il convient de toujours faire preuve de sensibilité et de les encourager à partager leur histoire.
Prenez le temps de bien introduire et conclure toute unité d’apprentissage
Cette pratique met l’accent sur la manière d’introduire et de conclure toute unité d’apprentissage sur l’Holocauste afin d’outiller les élèves pour aborder ce sujet délicat avec discernement. Au début de chaque période de cours, réitérez l’engagement commun de faire de la classe un espace sûr en reconduisant les contrats de classe préalablement établis. Donnez une définition claire de l’Holocauste pour introduire le sujet et soyez toujours précis dans les termes employés. Notre ressource Premiers repères constitue un excellent outil pour vous guider dans l’adoption des meilleures pratiques en enseignement de l’Holocauste. Ne terminez pas l’unité sur un propos particulièrement bouleversant. Plutôt que de clore l’apprentissage en évoquant la libération des survivants, intégrez des récits d’humanité et de résilience, et soulignez l’engagement et les contributions de survivants. En outre, prévoyez cinq à dix minutes à la fin de chaque période de cours pour offrir la possibilité aux élèves d’écrire leurs réflexions dans un carnet de bord ou de partager leurs ressentis en petit groupe ou avec le reste de la classe. Cette pratique permettra à vos élèves de se recentrer avant de poursuivre d’autres activités d’apprentissage.
Intégrées en partie ou intégralement dans la planification de vos activités en classe, ces pratiques vous permettront d’accompagner au mieux vos élèves dans leur apprentissage sur l’Holocauste. N’hésitez pas à nous contacter par courriel si vous avez la moindre question.
1 Voir section de Traumatismes, résilience et personnel scolaire
2 Bigé, Emma. « Interrompre le cycle des violences, transformer la communauté », dans Multitudes : revue politique, artistique, philosophique, Paris, Association Multitudes, 2022/3, p. 66

